Explorar los documents (1009 total)

Benichou, Julien. Compositeur
Benichou, Daphné. Interprète
Alranq, Perrine. Interprète
Vidal, Alain. Interprète
Zinner, Lucas. Interprète
Huang, Edda. Interprète
Tèxte de l'episòdi 10 :
La nèit foguèt corteta e lo revelh amb lo desfasament orari mai que dificil. La paura Joana beguèt son tè sens saupre ont’èra : urosament vegèt de l’autre costat de la carrièra, dins lo jardin ont se passejavan los esquiròls, un drapèl plantat qu’èra pas un drapèl frances ni mai un drapèl occitan mas lo del país mai grand del mond occidental, the United States of America.
- "Bondieu aquò’s estranh, es qu’aicí plantan los drapèls dins los jardins perque fan de frucha ?"
- "Non, es un biais de dire de quin costat òm es : los republicans amb lo drapèl US an una pancarta ont se pòt legir « Support our troups» e, se gaitas dins l’autre jardin, avisas que son de democratas per de que an una pancarta ont es escrich : « War is not an answer », « Obama president ».
- "Com’aquò cadun sap çò que vòta son vesin ! Es mai simple, pas d’embolh !"
- "Joana, aurem lo temps de parlar dins la veitura, vai t’en te vestir. Despacha-te. Comenci a 11 oras : es una leiçon sus la trobairitz La comtessa de Dia."
Èra encara la calor de l’estiu, aviái mes una rauba jauna e roja. Partiguèrem e me virèri : Matilda aviá mes sa cara a la fenèstra, mas pensi pas que me vegèt.
Semblava d’èstre endacòm mai. Èra lo primièr còp que la daissava per una jornada. Li aviái daissat 100 dolars, se se voliá crompar quicòm, òm sap jamai !
Romieg èra urós; siblava lo « Se canta ».
- "Madama es vestida coma un drapèl occitan, per un cors de lenga romana es una bona idèia : fa folcloric. N’i a qu’an lo drapèl dins lo jardin e d’autres que se'n vestisson !"
- "Tu sès vestit coma un professor : a cadun son mestièr."
Romieg me prenguèt la man :
- "Me fa plaser d’èstre ambe tu !"
- "Ieu tanben mas soi inquieta d’aver laissada Matilda soleta !"
- "Matilda es majora, pòt viure sens una maire a son costat."
Èrem sus una autostrada, puèi virèrem vers UMBC es a dire : University of Maryland Baltimore County. Una universitat publica.
Ieu qu’aviái passat tota ma vida dins la pòsta de mon vilatge me sentissiái coma un enfant a costat d’aqueles buildings grandaràs amb d’estudiants que corrissián de pertot, de totas las colors e subretot que parlavan pas que l’anglés. Pas totes : ausiguèri parlar espanhòl tanben. Cada còp que Romieg rescontrèt quauqu’un que conneissiá me presentèt : « Joana Belcaire, una amiga d’enfança, venguda del miègjorn de França e que parla la lenga occitana qu’ensenhi dins mos corses. »
Compreniái pas tot mas ensajavi de faire aquela que… en fasent fòrça sorires e Hello !
Benlèu que dins gaire de temps gausariái dire : how are you ?
Èrem enfin arribats dins la classa ont los estudiants de Romieg nos esperavan.
- "Today we will leave la Contessa de Dia and speak occitan. Joana does not understand a word of English. She came especialy from her country to meet you and as you are all very polite you must talk with her."
Tot lo mond comencèt de rire. Èra trop difficil per eles de mestrejar la lenga occitana. Donc Romieg faguèt las reviradas de l’anglés en occitan e de l’occitan en anglés. Mas n’i aviá qu’ensajavan de me comprene e disián qu’èra mai simple que lo francés per de que èra pròche de l’espanhòl.
Las questions viravan a l’entorn de la lenga, del vin, dels buòus :
- "Do people still speak occitan in the sreet?"
- "Do you drink wine every day ?"
- "Do you like to see bullfights ?"
Puèi Romieg me demandèt de cantar una cançon : Causiguèri la canson de Clara d’Anduza « en greu esmai ». Benlèu qu’una canson de « Mossu T e lei Jovents » coma « Lo gabian » seriá estada mai bèla per aqueles joves, mas coneissiái pas las paraulas.
L’aprèp dinnar i aguèt encara un cors.
Me regalèri : Matilda èra luènh.
Èri tant urosa d’èstre ambe tot aqueles joves e Romieg semblava de se regalar tanben.
Tornant a l’ostal me diguèt :
- "Es lo primièr còp que fau aquò e es un plaser. Domatge que la retirada siá tan pròcha… auriam poscut faire tantas de causas ensems."
- "Quand t’arrestaràs ?"
- "L’an que ven, e sabi pas çò que vau faire…Anam al subremercat a costat de l’ostal : Giant."
- "Ieu vòli de peis, d’ensalada verda, de rocafòrt, e de glacet. Es ieu que regali uèi !"
- "Ma Dòna es coma volètz !"
Quand paguèri ambe la carta Visa la caissièra me demandèt :
- "Cash ?"
- "De que vòl dire ?"
- "Lo supermercat es com’una banca. Se vòs aquela Dòna te pòt donar d’argent."
- "No, thank you !"
- "Òsca ! Començas de parlar !"
Arribèrem a l’ostal, èra lo ser mas l’ostal èra completament escur, pas un lum.
- "De qué se passa, Matilda es pas dintrada ?"
- "Te fagues pas de marrit sang : es anada se passejar, s’aviá passat quicòm auriá sonat mon telefonet !"
Romieg dubriguèt la pòrta d’intrada, portèrem las crompas dins la cosina. Sus la taula i aviá una letra.
Comencèri de tremolar : la tèsta de Matilda a la fenèstra aqueste matin tant luèncha !
M’assetèri, ara èra temps de legir :
« Joana
Sabi que ploraràs aqueste ser, mas seràs pas soleta : Romieg serà a costat de tu. Mercé per tot. T’o ai pas volgut dire mas aviái rescontrat un amorós per l’internet, e m'es venguda quèrre de Filadelfia. Se tot se passa plan amb el te tornarai sonar e quand vendrem en França serà a ton ostal. Vòli èstre liura de causir ma vida e èstre independenta. I aviá tròp d’amor entre nos : tot l’amor qu’as pas agut dins ta vida sens marit e sens enfant, tot l’amor qu’ai pas jamai agut ambe ma familha. Me fasiá paur.
Adieu e benlèu a un jorn, sabi pas quora.
Ta filha que t’aima Matilda
PS : Mercé a Romieg per son espitalitat. »
Foguèt la fin d’un pantais. Tot virèt a l’entorn de ieu.
Plorèri e parlèrem tota la nèit ambe Romieg : quand òm es vièlh i a un avenidor possible ? quand òm es jove òm pòt èstre urós tot sol ?
E ara de que faire : demorar, tornar a l’ostal…o cambiar completament de vida ?
FIN

Benichou, Julien. Compositeur
Alranq, Perrine. Interprète
Vidal, Alain. Interprète
Hébrard, Jean. Interprète
Benichou, Daphné. Interprète
Hommeau, Jean-François. Interprète
Vidal, Alain. Interprète
Huang, Edda. Interprète
Zinner, Lucas. Interprète
Tèxte de l'episòdi 7 :
E ara èrem dins l’avion. Dejós i aviá los camps, los vilatges e mai las vilas, e a l’entorn de la maquina d'Air Bus Industrie A319, las nívols blancas que s’estiravan coma de tablèus del Miquèl Àngel : èra lo primièr còp qu’èri dins lo cèl ! Mon còr fasiá tifa tafa ! Matilda semblava èstre ambe los àngels e, del fenestron, regardava la tèrra s’aluenhar. Quante plaser d’èstre amb’aquela pichòta, benlèu qu’èra pas qu’un sòmi ! Tot lo bonur de la vida m’èra tombat sus l’esquina e aviái res demandat : aviái l’amor d’una filha polideta e soleta e l’argent del tonton mòrt. Lo malastre dels autres fasiá mon bonur !
Dins l’avion i aviá un molon de retirats : èran totes ensems, en rengadas a l’intrada de la classa « economica ». Parlavan mai que fòrt e fasián de bruch : risián, cantavan « c’est un fameux trois mats fin comme un oiseau, hisse et ho Santiago » !
Èra un viatge organizat : l’auton en Florida, Miami Beach en riba de mar.
Nòstres sètis èran sus lo costat drech au mitan aprèp las alas. Dos sètis darrièr i aviá un coble : lo tipe grandaràs e magre com’un estocafich, 45 ans, los pels blonds tintats, la boca fina que semblava anar d’una aurelha a l’autra. La femna, granda tanben, los pels roge, grasseta e risolièra. Sus lo sèti de l’autre costat de l'alèa, èra assetat un òme de trenta ans mal vestit, los pels crassós, lo menton pelut, la boca amara. Parlavan totes tres amb un accent fòrça ponchut. Lors voses èran d’un autre mond : me semblava d’ausir un filme policièr. Dins ma tèsta virava la comptina de l’escòla de mon vilatge : « parisien, tête de chien, parigot, tête de veau » !
Las ostèssas nos portèron lo dinnar e per començar, l’aperitiu. Per festejar aquel grand jorn de partença beguèrem de champanhe. Puèi manjèrem, èra pas michant per « una classa economica ». Los parisencs, eles, s’arrestavan pas de sonar l’ostessa per demandar de oisquí. Aprèp lo cafè commencèri de dormir, un pichòt penequet seriá benvengut qu'èrem levadas dempuèi lo matin d’ora. Los retirats contunhavan de parlar e de rire.
Subte lo tipe crassós commencèt de cridar :
- "Eh les vieux fermez-là, moi je suis de Bécon les Bruyères et j’ai la haine. Tas de vieux clous !"
Un grand silenci tombèt e tot lo mond se virèt per veire qual cridava :
- "J'veux m'saoûler – à boire l’hôtesse ! - tournez-vous les vieux, j'veux pus voir vos faces de clowns sinon j'réponds pus de rien."
Lo grand blondàs commencèt de s’espetar de rire en cridant :
- "Va-z-y Bécon les Bruyères, fais leur voir qui tu es !"
L’autre se quilhèt e contunhèt :
- "Vous avez peur vieux bouts ? Nous on est jeune ! On fait l’amour et vous vous n’avez plus qu’à faire le mort ! A boire ! et plus vite que ça !"
- "Wisky à gogo sur l’Atlantique ! à nos femelles qui nous attendent à Philadelphie !"
Las gens (los vièlhs e los autres) s’escondèron dins los sètis. La paura ostèssa sabiá pas pus de qué faire, e quand la paura femna passèt dins l'alèa, lo tipe li bailèt un grand carpan sus lo cuól !
- "Olé ! l’Amérique est à nous !"
Quand quicòm com’aquò arriba en bas sus la tèrra, es pas agradiu mas enfin se pòt totjorn dire qu’òm pòt arrestar la maquina, dubrir la pòrta e sortir. Mas tot en aut dins lo cèl en dessús de la mar, de qué faire ?
Matilda me prenguèt la man :
- "Joana, son capbords e son bandats ! As pas paur ?"
Ara los dos tipes dansavan en cantant e en cridant :
- "R'gardez les vieux, nous on danse et on chante ! Eh ! La femme ! Viens avec nous !"
Mas la femna rossèla se volguèt pas levar per dançar.
- "A boire ! A boire !"
Mas las ostèssas venián pas pus. E d’un còp arribèt lo capitani de l’avion amb son vestit blau e daurat e son capèl. Èra pas solet : de l’autre costat i aviá un autre òme, un stewart.
- "Asseyez vous Messieurs. Nous ne sommes pas dans un dancing et nous vous prions de rester tranquilles."
- "Eh capitaine ! On a payé ! On fait c'qu’on veut non ?"
- "Si vous voulez repartir à Paris par le prochain avion, libre à vous…"
- "Eh ! Tu vas pas nous faire peur avec ton uniforme ?!"
- "Vous voulez être attachés à votre fauteuil pour la fin du voyage ?"
Lo capitani sortiguèt las manetas de sa pòcha e tot cambièt.
- "Capitaine, vous avez gagné, on s'tait !"
- "Les hôtesses ne vous donneront plus à boire et nous vous retrouverons à Philadelphie. Outrages à passagers…"
Tot d’un còp lo silenci foguèt rei amb lo bronzinament de l’avion. La paur de la polícia aviá fach son efièch. La vida tornèt dins « la classa economica », mas los retirats èran mens brusents. Los dos parisencs se calèron sens dire un mot de mai e comencèron de roncar, boca duberta : lo oisquí fasiá son trabalh ! I aviá encara 5 oras davant de se pausar. Matilda, cansada, dormiguèt coma un enfant. Ieu causiguèri d’agachar un filme : Harry Potter a l’escòla de las mascas, en francés. M’agradèt fòrça. Puèi demorèri los uòlhs dubèrts somiant : benlèu qu’èri capborda d’ensajar de tornar veire Romieg aprèp 35 ans ! Mas de tot biais èra una escasença de las bonas per viatjar ambe ma pichòta Matilda. Veirem ben, lo deluvi me fasiá pas paur.
L’avion comencèt sa davalada per l’aterriment : e los fromatges de cabra de ma sòrre qu’aviái amagats dins un tuperware, es que los trobarián dins la valisa a la doana ?

Benichou, Julien. Compositeur
Alranq, Perrine. Interprète
Vidal, Alain. Interprète
Hébrard, Jean. Interprète
Huang, Edda. Interprète
Zinner, Lucas. Interprète
Benichou, Daphné. Interprète
Tèxte de l'episòdi 6 :
L'endeman èra lo jorn de l’auton. Las vendémias èran acabadas. Anèri encò del notari. Li diguèri que voliái vendre las vinhas qu’èran pas afermadas quand tornariái. Se quaucun cercava …. Me diguèt :
« Ambe la crisi las solas tèrras que se vendan son aquelas ont se pòt bastir d’ostals per los retirats e los toristas. Mas òm sap pas jamai : un ric american per faire un vin especial… »
Per lo moment l’argent de l’oncle bastariá per faire la fèsta ambe Matilda : n’i aviá pron. Voliái pas lo dire a degun, mas sus lo papièr, degun l’ausirà pas : 500.000€ !
De tot biais me caliá escriure un mail a Romieg a Baltimore avant de cercar a crompar las bilhetas d’avion. Urosament Matilda – qu’èra fòrça urosa de partir ambe ieu - parlava l’Anglés e foguèt un’ajuda de las grandas : Romieg èra professor a UMBC-University of Maryland Baltimore County Campus. Son ostal èra dins Catonsville dins lo comtat pas dins la ciutat de Baltimore. Enfin trapèrem son numèro de telefòn.
Èri vergonhosa, mas lo me caliá sonar : i aviá pas d’autra causida per partir. L’aviái pas vist dempuèi 10 ans. Lo darrièr còp èra vengut per l’enterrament de sa maire (encara, aquò finira pas jamai ! mas aqueste còp èra dins lo cementari, l'enterrament, pas dins lo Vire los pes dins l’aiga ambe l’urna !) E l’ora per sonar? Cossí saupre quand travalhava ? ambe lo desfasament orari èra pas simple : sièis oras de mens.
- "Pensi que lo melhor es de lo sonar de matin : ai vist sus la mapa que l’universitat es pròcha de son ostal qu’es sus Hill View numerò 875."
- "Es dins lo campèstre ?"
- "Non mas deu èstre un ostal ambe un jardin coma ne pòdes veire a la TV."
- "Nos caldrà logar una veitura, autrament serem embarradas luènh de la ciutat ! Vòli veire de mond !"
- "Donc sonarem a doas oras aprèp dinnar : serà uèch oras del matin per el."
Abans de nos anar jaire avèm fach una virada sus los sits de « vols économiques ».
Per Baltimòre èra pas simple e fòrça long : Montpelhièr/Paris, puèi Paris/Filadelfia e, per acabar, Filadelfia/ Baltimòre. E mai se costava 1700 €, èra lo mens car.
Aviam la nèit per soscar.
Èra lo primier còp de ma vida dempuèi qu’aviái quitat l’ostal de la maire que podiái dire « bona nèit » a quaucun dins mon ostal e qu’aviái de projèctes de vida vidanta amb aquela persona. Benlèu que Matilda, polida coma èra, trapariá lèu lèu un òme e que me daissariá tombar coma un vièlh crostet : mas uèi èra la vida « d’ici et maintenant » comme ils disent les intellos, que m’apassionava.
L'endeman matin avèm parlat dels papièrs : los passapòrts. Avèm sonat la prefectura : per ieu tot anava plan. Matilda, ela, aviá un passapòrt biometric tot nòu : èri fòrça suspresa qu’aquela pichòta aguèsse aquò.
- "Lo jorn de ma majoritat ai volgut èstre liura de me laissar l’escasença de partir lo jorn onte seriá possible e de laissar aquel vièlh mond."
- "Mas sabes Matilda qu’es pas qu’un viatge de 3 meses qu’anam faire. Puèi tornarem."
- "Veirem ben : pensi que tot es possible a mon atge ! Ai tota la vida davant ieu e la vòli engolir."
Bon : aviái pas res a dire.
Doas oras arribèron :
- "Allo. Romieg. Es Joana. Joana Belcaire !"
- "Ah ! la Jeanne , ça fait plaisir d’ausir ta votz e subretot ton accent. E la lenga occitana, qu’aicí es pas simple de trapar quaucun per la parlar. Quel bon vent ?.."
- "Romieg : je voudrais venir te voir à Baltimore. Je suis retraitée et j’ai envie de voyager. Et j’aimerais beaucoup te revoir. Sès un amic per ieu dempuèi totjorn."
- "Joana me fariá plaser tanben. Mas ieu trabalhi e seràs soleta a l’ostal. Te languiràs tota la jornada e en mai parlas pas la lenga d’aquí."
- "Romieg : soi pas soleta !"
- "Coma ? As un òme ? Enfin ?! E ieu que cresiái..."
- "Non : ma filhòla es venguda viure ambe ieu !"
- "Quina filhòla ? La coneissi pas !"
- "Es la filha d’una amiga del collègi, Luciana. Sa maire es mòrta e ara es venguda viure ambe ieu."
- "E trabalha pas ?"
- "Voldriá aprene la dietetica. Commençarà l’an que ven."
- "Bon ! Strange ! Aquò me fa plaser. Vos espèri : pren las bilhetas e vos vendrai quèrre a l’aeropòrt BWI Baltimore. Espèri los oraris. Te fau un poton : a benlèu." - "Te fau un poton tanben e te sonarai lèu lèu !"
Matilda dansava sus la terrassa, tant urosa ! Puèi me venguèt faire un poton. E valsèrem totas doas en cantant « la mazurka sota lei pins ».
- "Cossí coneisses aquela canson ?"
- "Una regenta nos aprenguèt quauques mots d’occitan e de cansons tanben !"
Un ora aprèp aviam pres las bilhetas electronicas : lo primièr d’octòbre seriam a Cattonsville Maryland.


Oeuvres publiées conservées aux CIRDOC
- Chants de Noël en patois dans le Vivarais / Jules Seuzaret.-- Largentière : Humbert et fils, 1950. 11 p. Revue du Vivarais ; n. 550, 1950 (3) [CBB 442-31]
- Rampelado i felibre despatria : sounet = Appel aux félibres expatriés : sonnet / J. Seuzaret. Constantine, Soc. amicale Languedoc et Provence, 1928. [2] p ; 20 cm Texte occitan, trad. française en regard Annuaire de la Société amicale Languedoc et Provence de Constantine. 1928 [CBC 381]
- Plan ! Rataplan ! Plan ! Plan ! : rampelado i miejournàu = Plan ! Rataplan ! Plan ! Plan ! : appel aux méridionaux / J. Seuzaret. Constantine : Soc. amicale Languedoc et Provence, 1928. [6] p ; 20 cm Texte occitan, trad. française en regard Annuaire de la Société amicale Languedoc et Provence de Constantine. 1928 [CBC 382]
Manuscrits de Jules Seuzaret conservés au CIRDOC
- le ms. 173 contenant :- Au sujet de la graphie des dialectes d'oc (1954)(dactyl.)
- Discours de Jules Seuzaret à la Société Languedoc et Provence de Constantine (23 février 1836)
- Note sur l'origine de la Confrérie du Saint Esprit d'Aubenas (3 f.)
- Au sujet de l'empoi de A ou de O (1 f.)
- de Frédéric Mistral neveu à Jules Seuzaret 27 novembre 1954 - avec traduction (2 f.)
- de Adelin Moulis à A.J. Boussac 4 août 1954 (2 f.)
- de Jules Seuzaret à l'abbé Jouve 31 juillet 1927 (1 f.)
- de Jules Seuzaret à l'abbé Jouve 20 aout 1932 - avec traduction (4 f.)
- de Jules Seuzaret à Marius Jouveau 19 avril 1941 - avec traduction (2 f.)
- de Jules Seuzaret à l'abbé Auguste Roche 21 novembre 1935 (1 f.)
- de Jules Seuzaret à A.J. Boussac 4 aout 1954 (3 f.)
- le ms. 634(2) contenant
- Carte linguistique du Vivarais (1 f.)
- Los tempouro (poème)(2 f.)
- Co'i decida, vous pisorèi! (poème)(1 f.)
- Chonsou nouvialo (poème)(1 f.)
- Per chonta entre Ordechoua (poème)(1 f.)
- Proujout d'aveni(poème)(1 f.)
- Mo Muso (poème)(1 f.)
On connaît également de Jules Seuzaret
- "Notes diverses sur la Confrérie du Saint Esprit dite des Sabatiers d'Aubenas (1308-1541)", Revue du Vivarais, 1936 (1-2)
- "Le Vivarais du point de vue linguistique et ethnographique", Revue du Vivarais, avr.-juin 1942
- "L'aérolite de Juvinas", Revue du Vivarais, 1950 (1)
Manuscrits inédits
- La Jouonado ( Le Feu de la Saint Jean) récit en dialecte vivarois, traduction française en regard (1929).
- Obro potoueso de l'abe Sevenie, extraits de l'Ormogna déi Feçouiriè de 1886-1888, transcrits selon la graphie mistralienne (1937) .
- Vuelios causo des vivores, recueil de poesies et de récits en dialecte du Vivarais et de chants et monologues entre vivarois.
- Chants de Noël en patois dans le Vivarais (1944) -Lettres patoises en Vivarois ou en Provençal.
Ref. biographiques
- L’Ardèche parisienne octobre 1950 coupure de presse Archives départementales de l’Ardèche Fonds Mazon 52J46 (20)
- François Pic, « Catalogue d'une cinquantaine de manuscrits de dictionnaires et glossaires occitans complément à la bibliographie des dictionnaires patois gallo-romans », Revue de Linguistique Romane, T. 63, 1999, p. 201-214. (notice XLVI erronée)


Nicolas Saboly est sans conteste le rédacteur de noëls - cantiques en langue vulgaire célébrant la Nativité - le plus connu aujourd'hui. Réputé au XVIIe siècle pour la saveur de ses textes, il apparaît aujourd'hui comme le principal acteur de la tradition provençale autour de Noël.
La tradition des chants de noël
Le genre des noëls, apparu au XIe siècle, rencontra à l'époque un grand succès. Les noëls étaient alors les seuls chants en langue vulgaire autorisés dans les églises, compréhensibles par le plus grand nombre. Pouvant s'inspirer de sujets d'actualité ou des coutumes locales, ils sortent du champ liturgique pour s'imposer en tant que véritables airs populaires.
Chaque grande ville, chaque région avait dans le courant du XVe et du XVIe siècle son noëlliste attitré qui, chaque année, aux alentours du 25 décembre, publiait ses cantiques. Parmi ces noëllistes, figuraient des membres du corps ecclésiatistique, des organistes mais aussi quelques clercs, souvent compositeurs d'airs populaires.
Nicolas Saboly, sa vie
Nicolas Saboly, est pour sa part un noëlliste provençal. Il naît dans le Comtat Venaissin, à Monteux, le 30 janvier 1614 dans une famille de consuls.
Issu d'une famille d'éleveurs, il grandit au milieu des bergers et des troupeaux de moutons.

Destiné à l'état ecclésiastique, il entre très tôt au collège de Carpentras chez les jésuites avant d'être nommé à 19 ans recteur de la chapellenie de Sainte-Marie Madeleine, fondée au maître-autel de la cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras.
En 1635 il est appelé au sous-diaconat, diaconat et prêtrise avant d'être nommé maître de chapelle et organiste de la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.
La publication des noëls
C'est à cette date que Nicolas Saboly semble avoir commencé à composer ses noëls, dans un premier temps pour ses intimes, puis publiés plus tardivement.
Il ne nous reste aujourd'hui aucune trace des manuscrits de Nicolas Saboly mais on sait que ses noëls ont été publiés de son vivant entre 1669 et 1674, chaque année sous la forme de petits fascicules. En tout, un peu plus d'une cinquantaine de noëls lui sont attribués, tous écrits en langue occitane.
Nicolas Saboly aurait composé très peu de musiques pour accompagner ses noëls. Il était alors de tradition d'écrire les paroles des chants sur des airs populaires empruntés à d'autres compositeurs ou à des airs d'église. Nicolas Saboly a souvent repris des airs à la mode pour accompagner ses compositions. En témoigne son cantique « La Bona Novela » dont la trame musicale s'appuie sur une gavotte de Praetorius devenue ensuite l'air d'une bourrée à deux temps en Berry : « En passant la rivière ».
Ainsi, seules une dizaine de mélodies auraient été composées par l'auteur pour accompagner ses chants.
Le contenu des noëls
Par le biais de ses noëls, Nicolas Saboly déplace la scène de la Nativité en Provence, en lui confiant tous les attributs de la coutume comtadine.
La plupart de ses cantiques font apparaître des bergers, venant des coteaux du Comtat Venaissin. Ce sont ses propres contemporains qu'il met ainsi en scène reprenant dans ses noëls leur parler, leurs moeurs, leurs habitudes mais aussi leurs légendes et des aspects de leur religion populaire.
Dans ses poésies d'inspiration populaire, apparaissent régulièrement des éléments d'actualité. Ses sentiments politiques ont même pu apparaître dans certains noëls, notamment son attachement aux "Pévoulins", gens du petit peuple meneurs d'une révolte en Avignon en 1653 contre les "Pessugaux", soutiens de l'administration pontificale. Un des premiers noëls qui lui est attribué, « Nouvé de l'an 1660 après le mariage de Louis XIV », outre son titre, évoque également dans son contenu le mariage du roi et la conclusion du traité des Pyrénées, marquant la fin de la guerre de Trente Ans. Dans l' «Estrange Deluge » publié en 1674, il fait allusion à la terrible inondation d'Avignon survenue la même année. Enfin, dans « La miejo nue sounavo » publiée en 1672, il fait référence à la Guerre de Hollande commencée la même année.
Enfin, on ne peut pas ignorer l'aspect éminement satirique des textes de Nicolas Saboly, ce dernier dotant souvent ses écrits de traits moqueurs et critiques contres les prêtres, les gens du monde, les nobles et magistrats, les riches et les pauvres. Ainsi un de ses noëls les plus célèbres, « I a proun de gens » (connu aussi sous le titre « La cambo ma fa mal ») aurait été rédigé pour se moquer d'un curé boiteux dans l'entourage proche de l'organiste de Carpentras.
Le dernier recueil de noëls de Nicolas Saboly sera publié en 1674 mais tous ses cantiques se sont largement répandus dans la culture populaire avant d'être transmis jusqu'à nous aux côtés des noëls de Natalis Cordat (1610-1663) ou encore ceux de N.D. Des Doms.
Pour aller plus loin...
Voir les partitions des noëls de Saboly sur Occitanica.
Voir sur Lo Trobador, toutes les éditions des noëls de Saboly.
Voir sur Lo Trobador tous les ouvrages sur la vie et l'œuvre de Saboly.

Benichou, Julien. Compositeur
Gaspa, Marie. Interprète
Capron, Michel. Interprète
Hébrard, Jean. Interprète
Vòli pas plorar : uèi l’oncle Vincent se n’es anat. Es totjorn estat un tipe un pauc malbiaissut mas aviá pas oblidat lo sorire e la convivéncia ambe los qu’aimava : de segur èra pas un trobador. Me cal vos o dire, de trobaires, se'n tròba pas pus dins lo vilatge : a ! Si ! Lo papet Bertrand, al cafè de la Prima, quand a engolit tres o quatre pastagàs se soven del temps onte sa grand cantava e contava : alara lo cèl càmbia de color e sos uòlhs s’emplisson de lagremas que davalan sus sa pèl cuècha al solelh e roge de tant de còps beguts entre las socas de sa vinha.
Me presenti : ieu soi Joana Belcaire, la vièlha filha dau caire, sessanta ans, grandassa per una femna dau miegjorn (1m67), ni magra ni grassa, los uòlhs blaus tròp gròs per èstre polits, lo menton ponchut, los pels blondàs per amagar la blancor de l’atge, la boca granda e fina, la pèl blanca e roja . N’i a que dison que dins mon folhum soi estada una bèla planta : mas degun m’agradava pas. E quand me passegi per carrièra me fa plaser de tornar vèire los vielhs amorós de ma joinessa.
De còps que i a, vesi encara la flama de l’amor de luènh s’alucar dins lo : "Bonjorn Joana, cossí vas ? Totjorn redda e l’esquina drecha com’una joventa ! » Aqueste matin la cançon es cambiada quand rescontri dins la carrièra Nauta lo Renat – qu’èra tant polit e un de los qu’ai aimat tant e tant per mos vint ans. Mas sens res me dire aviá fach un enfant a la Roseta e èra estat forçat de la maridar. Ara es retirat : èra emplegat al servicis de la Comuna. : "E ben! ton oncle nos a laissat , es anat beure un còp encò del Bon Dieu. Pecaire, lo Vincenç èra pas un grand òme mas èra un òme qu’aviá totjorn trabalhat e susat per esparnhar tanben. Quales son los eretièrs ? Aviá ges d’enfants e es tu la mai pròcha. Vas devenir un partit interessant : benlèu que traparàs enfin un marit. Serà pas trop lèu !" .
Verai que l’oncle Vincenç m’a daissat tot çò qu’aviá : es a dire un ostal, sas vinhas – 20 ectares, e son compte a la banca. Mas caldrà esperar un pauc per saupre quant d’argent i a per ieu. Comenci de pantaissar : dins mon sovenir i a un òme, Romieg, qu’ai pas jamai poscut oblidar : cada mes de genièr me manda una letra de Baltimòre, dins lo Mariland en America, per l’an novèl. Èra maridat amb una americana qu’es mòrta, ara. Èra professor de lenga romana a l’universitat e coma dins aquel país trabalhan tard, deu totjorn ensenhar. Es temps de viure ara, es temps de viatjar : soi estada emplegada de la Pòsta tota ma vida, ai pas jamai agut d’enfants. La rason rasonabla, e mos cats qu’ai pas jamai volgut abandonar, m’an empachat de viure d’afons. Vòli un lifting, de vestits a la mòda, me caldrà aprene un pauc l’anglés (pensi pas que se pòsca aprene l’amerlòc) e partirai rejónher l’amor de ma vida dins lo país d’Obama : l’aventura es a ma pòrta, la me cal durbir per la faire dintrar : un dos tres….
Me cal beure un pichòt veire de Tuilet qu’ai crompat a Estagel, que l’aimi tant : es doç aquel vin quand passa dins la garganta. Ara soi dins lo sèti que m’a laissat ma grand, los pès sus una cadièra, me vòli negar dins mos pantaisses. E primièr me caldrà anar veire, lo notari. Mas mon pichòt det crida com’un fadòli :
-"Joana : primièr te cal enterrar l’oncle Vincenç, passar per lo crematorium e convidar lo vilatge a beure un còp".
- "As rason : champanhe per totes sus la terrassa de l’oncle Vincenç ! Non, dins mon ostal !"
- "De còps que i a semblas de pas èstre una femna d’aquí : es pas de champanhe que vòlon beure totes : vòlon de pastís e las femnas de muscat de Rivesaltas !"
- "As totjorn rason ! Farai com’as dich. E ara al trabalh lo monde es a ieu ! Romieg : a tu per la vida".
E lo Tuilet davalèt dins mon estomac.
Me cal veire sus l’ordenador ont’es Baltimòre, la baia del Cheasepeake - deu èstre dificil de mastegar aquel nom-: Mappy, non me cal clicar sus Estats-Units… cercar Mariland … Mas vaquí que quauqu’un sona a la pòrta : qual pòt èstre : lo notari, los cosins, un amorós o benlèu un panaire ?.....


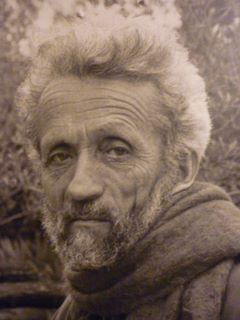 Né le 22 février 1922 à La Capelle-Masmolène dans le Gard, Aimat Serre s'est engagé toute sa vie dans les mouvements de défense et de valorisation de la langue d'oc, ainsi que dans le milieu éducatif. Homme aux multiples talents, il fut ainsi tour à tour instituteur puis professeur (Histoire, Géographie, Occitan), écrivain, traducteur mais aussi militant.
Né le 22 février 1922 à La Capelle-Masmolène dans le Gard, Aimat Serre s'est engagé toute sa vie dans les mouvements de défense et de valorisation de la langue d'oc, ainsi que dans le milieu éducatif. Homme aux multiples talents, il fut ainsi tour à tour instituteur puis professeur (Histoire, Géographie, Occitan), écrivain, traducteur mais aussi militant.
L'enfance
Aimat Serre voit le jour dans le Gard du début du XXe siècle, dans un petit village de l'Uzège. Ses parents cumulent les emplois. Son père, Edouard Sèrra est ainsi mineur (mine d'argile) et paysan, tandis que sa mère travaille à la fois comme chevrière et couturière.
Des années plus tard, devenu adulte, Aimat Serre racontera ses souvenirs d'enfance dans un livre, Bogres d'Ases (1974). Rédigé à la première personne et en occitan, cet ouvrage dépasse toutefois la seule ambition autobiographique. Endossant les habits de l'historien et de l'ethnologue, Aimat Serre nous plonge dans le quotidien des campagnes occitanes des années 1930. Nous y découvrons "[...] un monde constamment agressé, un type d'existence dans les marges, une société toute proche, voisine dans le temps, contemporaine encore, souvent présente en chacun des lecteurs à son insu ; une vie parallèle à l'officielle, dans son ombre épaisse, avec sa langue, ses comportements, sa vergogne face à l'école, aux médias, à l'administration. » pour reprendre les mots de l'auteur lui-même, commentant son ouvrage (Bogres d'ases, Avant-propos.). L'auteur y dresse le portrait d'un des « hussards noirs » de la République, enseignant tant le français que le mépris de la langue d'oc, ce « patois » que l'auteur avait appris dans le cercle familial.
Bien que marqué par l'attitude de son instituteur, Aimat Serre s'engagera lui-même dans la voie de l'enseignement et dans le militantisme occitan.
Militant et pédagogue.
Elève de l'Ecole Normale de Nîmes, puis étudiant en Faculté de Lettres à Montpellier, Aimat Serre fut instituteur puis professeur d'Histoire-Géographie et d'Occitan. Il a consacré une grande partie de son activité à la défense de l'éducation en français comme en occitan. Animateur de la calandreta de Nîmes qui porte aujourd'hui son nom, il y diffusa les principes de la méthode Freinet. Aimat Serre a également été un acteur-clé du mouvement en faveur de l'enseignement de l'occitan au plus grand nombre : dans les calandretas, les écoles, collèges et lycées publics, mais également dans le cadre d'ateliers adultes.
Homme engagé, Aimat Serre participa aux grands moments de la revendication occitane. Nous le retrouvons ainsi dans le Larzac lors des manifestations du début des années 1970. Il fut surtout un élément déterminant dans la création du Cercle Occitan de Nîmes, de la MARPOC (Maison pour l'Animation et la Recherche Populaire Occitane) et dans celle de l'Université d'Eté occitane.
Doté d'une bonne plume, il contribua par ses articles parus dans divers journaux occitans (Jorn, Oc) et français (Éducateur, La Voix Domitienne...) à faire (re)connaître et apprécier la langue d'oc. Ses chroniques sur Radio-France Nîmes eurent à cet égard un franc succès. Portant un regard d'ethnologue et de sociologue sur son époque, Aimat Serre a ouvert une voie nouvelle et complémentaire aux travaux sur la langue et la littérature de ses contemporains.
L'écrivain
Bogres d'Ases son premier ouvrage fut un succès critique et d'édition (paru en 1974 et 1988, il fut à chaque fois rapidement épuisé). Suivirent différents articles, mais également deux ouvrages, dont Mòts de Jòcs et Les rues de Nîmes.
Mòts de Jòcs parait en 1984 . Ouvrage anonyme (de Nîmes, premier des jeux de mots de l'ouvrage), il propose une trentaine de jeux de mots en occitan, témoigne des qualités de plume d' Aimat Serre, et donne un bref apperçu de l'humour de l'homme.
Les Rues de Nîmes est le fruit d'un long travail de recherche. Pédagogue, Aimat Serre nous invite à découvrir l'histoire de la Rome française, à travers le nom et l'histoire de ses rues, du Moyen Âge à nos jours, et y démontrer à travers les noms la profonde occitanité de sa ville..
Il participa également à la rédaction d'ouvrages scientifiques mais aussi éducatifs (Poëtpoëta lo jardinièr. Nîmes, 1990) fut traducteur en occitan de Ieu, Bancel, oficièr d'empèri de Jòrdi Gros (Toulouse, 1989), ou encore narrateur aux côtés de son ami Robert Lafont (Omenatge a Bigot. Nîmes, 1969).
Son décès en 1993, donna lieu à de nombreux articles (cf. En savoir plus). Ses amis, Jorgì Peladan, Robert Lafont, Jordi Gros... ainsi que d'anciens élèves, prirent pour l'occasion leur plume afin de rendre hommage à l'homme, à l'auteur et au militant.
En savoir plus :
La creacion occitana : Lemosin e Perigòrd, Lengadòc, Miègjorn-Pirenèus e Val d'Aran : catalògue. Toulouse, 1990, p77-78.(COTE CIRDOC: CAC 3346).
Revues :
Occitans! n° 57, septembre-octobre 1993, p.20.(COTE CIRDOC: KII-1).
L'Occitan, n°107, novembre-décembre 1993, p.7. (COTE CIRDOC: H-4).
Aquò d'Aquí, n°78, 1993, p.12. (COTE CIRDOC: BI-2).
Lo Gai Saber, n°452, 1993, p.301.(COTE CIRDOC: S6).
La Voix Domitienne, n°20, 1993, p.4-5. (COTE CIRDOC: 0-2).
Ouvrages d'Aimat Serre :
SERRE, Aimé, Bogres d'ases,Toulouse, 1988. (COTE CIRDOC: R.LAN SER b).
SERRE, Aimé, Les rues de Nîmes, Montpellier, 1989. (COTE CIRDOC: CAC 2988).
SERRE, Aimé, Mòts de jòcs, Nîmes, 1984. (COTE CIRDOC:CBB 429-12 ).
SERRE, Aimé, Poëtpoëta lo jardinièr, Nîmes, 1990. (COTE CIRDOC: CAM 83-5 ).


Dans un manuscrit autographe (CIRDOC Mi B-4 TJS-III p.257-263) Junior Sans présente ainsi cette chanson :
« Chanson faite à la grange de Peitavi-Saint-Julien en avril 1892.
La semaine dernière, je trouvais, en fouillant mes vieux papiers une autre Chanson des Treilles que mon pauvre père avait composé et fait imprimer en 1825, à l'occasion du sacre de Charles X, qui fut sacré à Reims, le 29 mai. Une autre Chanson des Treilles, par un vieux troubadour, qui n'était autre que Bourguet le médecin, et pour la même occasion du Sacre.
Ce Bourguet mourut en 1835, le lendemain [du jour] où je venais de faire une chanson sur le choléra. J'étais loin de penser que la chanson achevée, il allait mourir du choléra le lendemain. Cela est la pure vérité ».
Il précise que pour cette inauguration :
« la Musico royale de Barcelonne (sic) vint rendre sa visite à notre musique la Lyre Biterroise qui était allée à Barcelonne (sic) quelques mois auparavant ».
Il ajoute :
« Ces deux vieilles Chansons des Treilles, après les avoir lues, je les portai chez mon ami et confrère en félibrige Frédéric Donnadieu, qui a de nombreux manuscrits du Docteur Bourguet et qui se propose d'écrire sur ses travaux phonétiques. Moi, je l'ai bien connu car c'était mon médecin quand j'étais tout jeune, et puis, entre chansonniers, ils se connaissaient avec mon père Julien ».
« Cansou facho à la granjó de Peitavi-Sant-Julian, avril 1892.
La semano passado trouvèri en fourfoulhant mous vièlhs papiés uno autro Cansou de la Trelhos que moun paure paire avio coumposado e facho emprima en 1825, a l'oucasion del sacre de Charles X, que sièguet sacrat à Rheims, lou 29 de mai - Uno autro Cansou de las Treilhos, per un vièlh troubadou, que n'èro autre que Bourguet lou medeci, e per la mème oucasieu del Sacre.
Aquel Bourguet mouriguèt en 1835, lou lendema que venió de faire uno Cansou sul Coulera. Ero lènt de pensa que la Cansou acabado, mouririó del Colera lou lendema. Acò's la puro veritat ».


Jobbé-Duval, Émile (1851-1931)


Troubadours au féminin, femmes et auteures en un temps peu favorables à la reconnaissance de leurs droits, les « trobairitz » n'ont pas échappé depuis au double écueil des préjugés ou tout au contraire du mythe. Pourtant, tour à tour louées ou condamnées, leurs productions n'en demeurent pas moins quasiment méconnues. Qui étaient les « trobairitz » ? Quelle fut leur production ? Leur voix et les thèmes qu'elles abordèrent, sont-ils différents de ceux de leurs homologues masculins ?
I. Les Trobairitz, femmes troubadours
L'art du Trobar
Les XIIème et XIIIème siècles voient apparaître un nouveau mouvement poétique dans la partie sud de ce qui constitue aujourd'hui la France. En langue qu'ils appellent eux-même « romane » (cf. RAYNOUARD, François, Choix des poésies originales des troubadours, Genève, Paris. 1982. T.I. Introduction, p. 5-32) et que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'occitan, ces poètes et musiciens développent l'art du trobar et chantent la fin'amor, joi et joven (amour raffiné, joie d'amour et jeunesse).
Mouvement poétique majoritairement constitué d'hommes, l'art du trobar vit également émerger une production féminine entre 1150 et 1250. Ces femmes troubadours, également connues sous le nom de trobairitz (forme occitane classique du féminin des mots suffixés en « or »), furent, au regard des sources conservées actuellement, une vingtaine. (Meg Bogin, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978, p. 15)
Leurs noms et leurs productions nous sont principalement parvenues grâce à des manuscrits qui sont également nos sources d'informations majeures pour les troubadours. (cf. P. Bec, Chant d'amour des femmes troubadours, Stock, 1995, p. 17).
Les sources
Les vidas e razós (courts textes biographiques expliquant les raisons pour lesquelles les poèmes ont été écrits), constituent les principales sources permettant de connaître la biographie de certains troubadours et trobairitz. Vingt-huit chansonniers sur les quatre-vingt-quinze parvenus jusqu'à nous, présentent des textes, complets mais aussi parfois partiels, faisant intervenir une voix féminine (P.BEC, op.cit.Pp.17).

Deux de ces manuscrits sont particulièrement riches :
-
Le manuscrit H (Rome, Vatican, Lat.3207), copié en Italie au XIVème siècle. Outre de nombreux textes de trobairitz regroupés sous une même rubrique, ce manuscrit a la particularité de proposer huit enluminures de femmes-troubadours.
- Le manuscrit W (Paris, Bibliohtèque nationale. Fr 844. Olim Mazarin 96) appelé aussi "Manuscrit du roi". Contenant différentes chansons françaises mais aussi occitanes, il présente notamment la chanson de la Comtessa de Dia, "A chantar m'er de so que no volria", unique chanson de trobairitz dont nous possédions la musique (pour plus d'informations sur le sujet, consulter l'ouvrage d'Ismaël Fernandez de la Cuesta, Las cançons dels trobadors. IEO, 1979).
Ces différentes sources ont permis d'identifier une vingtaine de femmes troubadours, entre 1150 et 1250, et d'obtenir pour certaines d'entre elles, des éléments d'identification Il faut noter toutefois que les vidas des trobairitz, rédigées près d'un siècle après la mort de ces auteurs, se résument la plupart du temps à quelques lignes. Par ailleurs, la plupart des trobairitz sont principalement connues par une razó ou la vida d'un troubadour proche ou avec lequel elles partagèrent une « tenson ».
En dépit de sources limitées, les chercheurs ont pu dresser le portrait de ces poètes féminines. Il semble que ces femmes aient principalement été issues de milieux favorisés, ce qui explique qu'elles aient eu la possibilité de composer en un temps pourtant peu favorable au « sexe faible ». Elles fréquentaient d'ailleurs les mêmes cours que leurs homologues masculins. Les plus connues d'entre elles furent Almuc de Castelnòu, Iseut de Capion, Azalais de Porcairague, Na Castelloza, la comtesse de Die, Na Lombarda, Marie de Ventadorn, Na Tibors (soeur de Raimbaut d'Orange). (cf. à ce sujet l'ouvrage de Meg Bogin. op.cit. p. 15).
II. La réception des trobairitz au cours des siècles
La redécouverte du XIX° siècle
Au XVIIIe siècle, le travail mené conjointement par Dom Vaissette et Dom Vic lors de l'élaboration de leur Histoire du Languedoc, ouvre la voie d'un retour aux sources et au textes du Moyen Âge. Le regain d'intérêt pour la littérature des troubadours ouvre alors également la voie à une (re)découverte de la production de leurs homologues féminines. Différents érudits français tels que Jean-Pierre Papon (Histoire générale de la Provence, 1778) ou Rochegude (Parnasse occitanien, 1819) mentionnent quelques exemples de trobairitz au cœur de leurs ouvrages.
Les courants romantiques français puis allemand s'intéressent à leur tour à la question et en 1888 paraît Die provenzalischen Dichterinnen de O. Schultz-Gora, monographie allemande d'une quarantaine de pages qui sera pour longtemps l'ouvrage de référence sur la question, et surtout, la seule étude globale. (cf. Pierre Bec, op.cit. p. 60).
Toutefois, le jugement moral porté sur la production de ces poètes au féminin, est alors très dévalorisant comme en témoigne la citation suivante d'Alfred Jeanroy, illustre érudit français du XIXème : “ Je croirais volontiers que nos trobairitz, esclaves de la tradition, incapables d'un effort d'analyse, se bornaient à exploiter des thèmes existants, à se servir de clichés qui avaient cours, intervertissant seulement les rôles. Nous serions alors en présence de purs exercices littéraires, qui ne sont d'ailleurs pas dépourvus de mérites”. (cf ; A. Jeanroy, Mélanges. In :Action Poétique. Les trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, 1978, p. 5). Ce jugement dévalorisant, repose sur des conditions morales.
Le tournant des années 1970
Il faut attendre les années 1970-80 pour que, à la faveur du mouvement de libération de la femme qui traverse alors les sociétés occidentales, paraissent de nouvelles études sur le sujet. En 1976, l'ouvrage de l'américaine Meg Bogin, Les femmes troubadours, apporte une vision nouvelle et positive de la voix féminine dans l'art du trobar. L'ouvrage, qui eut le mérite en son temps de proposer de nouvelles pistes de réflexion quant au contexte de rédaction des pièces des trobairitz, a toutefois le défaut de ses qualités. Le propos de l'auteure souffre ainsi de son engagement pour la cause féminine, lui demandant un effort pour prendre le recul nécessaire à tout travail de recherche.
L'analyse contemporaine
Alors que la production des trobairitz avait souffert jusque-là d'une ré-utilisation parfois politique bien loin du propos original de ses auteurs, la fin des années 1980 voit paraître de nombreuses études plus objectives à ce sujet. Nous devons ainsi à Pierre Bec un ouvrage sur la lyrique féminine ayant fait le point sur la question et ouvrant la voie à de plus larges réflexions (Chants d'amour des femmes-troubadours. Stock, 2005). Avant lui, Robert Lafont dans sa Nouvelle Histoire de la littérature française (P.U.F. 1970), mais aussi René Nelli (Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris, 1977) avaient également permis de faire avancer la connaissance sur le sujet, tout comme plus récemment G. Zuchetto (Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris : 1996).
Toutes ces analyses ont pour point de départ la recherche du côté de la production de ces œuvres: qui fut l'auteur de telle ou telle pièce, s'agissait-il réellement d'une œuvre d'une trobairitz ou d'un troubadour, qui était cette femme et quelle était son origine ? Des recherches préalables, tirant partie d'un mince mais riche corpus d'une trentaine de textes.
III. L'écriture des trobairitz
La femme du Haut Moyen-Âge et la culture
La production des trobairitz, qui renvoie au-delà de la seule analyse littéraire, à la question de la place de la femme durant le Haut Moyen-Âge, divise aujourd'hui encore les chercheurs. Quelques auteurs soulignent le statut particulier de ces femmes qui, dans une société principalement conçue et dirigée par des hommes, eurent la possibilité de s'exprimer par la voie des lettres et des arts (Meg Bogin. op.cit). D'autres, plus nombreux, tiennent à nuancer ce propos.
S'il est vrai que la femme occitane bénéficia d'un certain nombre de droits, notamment le droit d'hériter à l'instar des hommes, mais aussi l'accès à l'éducation, ces spécialistes nous mettent en garde contre la tentation de faire des trobairitz le symbole d'une condition féminine exemplaire dans le monde occitan du Moyen-Âge. Plus que tout autre facteur, il semble que ce soit au contraire le statut social privilégié de ces femmes, principalement issues de l'aristocratie, qui leur ait ouvert la voie de l'écriture.
Surtout, l'existence d'une voix féminine dans l'art du trobar signifie-t-elle l'existence d'une écriture spécifiquement féminine, proposant ses propres règles et ses propres codes ?
La production des trobairitz
Le faible nombre de pièces parvenues jusqu'à nous, une trentaine environ pour les trobairitz quand dans le même temps les écrits des troubadours s'élèvent à près de 2500, témoigne du faible nombre de femmes ayant composé à cette époque. Une impression à traiter avec circonspection toutefois, le temps ayant pu conduire à la disparition ou à la destruction de nombreuses pièces au cours des neuf siècles qui nous séparent de leurs auteurs.
La poésie des trobairitz telle que ces sources nous la donnent à voir, traite de thématiques communes à celles développées par les troubadours : la fin'amor, joi e joven. Quant à la forme, il semble qu'elles aient également adopté la plupart des genres poétiques propres à leurs homologues masculins, que ce soit les tensons (dialogue), voire, mais plus rarement, les sirventès (à caractère plus socio-politique) (cf. au sujet de leur production, l'ouvrage de Pierre Bec, op.cit p.2 ; ainsi que The Voice of the Trobairitz. Perspectives on the Women Troubadours ensemble de textes rassemblés par William D. Paden.
Six trobairitz sont auteures de chansons :
-
Azalaïs de Porcaraiga (vers 1173): 1 chanson conservée.
-
La comtessa de Dia (autour de 1200): 4 chansons conservées.
-
Clara d'Andusa : 1 chanson conservée.
-
Gormonda de Montpelhièr : 1 chanson conservée.
-
Castelhoza (environ 1210) : 4 chansons conservées.
-
Beiris de Roman : 1 chanson conservée.
Huit autres trobairitz ont écrit dans une tenson (Chanson à deux ou trois poètes qui se répondent de couplet en couplet. Voir Zuchetto p.31) :
Tensons entre trobairitz :
-
Almuc de Castelnou/ Iseut de Capion (Lubéron).
-
Alaizina Iselda/ Na Carensa.
Tensons entre trobairitz et troubadours :
-
Alamanda/ Guiraut de Bornelh
-
Maria de Ventadorn (1180-1215)/ Gui d'Ussel
-
Isabéla/ Ilias Cairel.
-
Na Lombarda/ Bernat Arnaut d'Armanhac.
-
Guilhelma de Rosers/ Lonfranc Cigala (troubadour italien).
-
Gansizda de Forcalquier/ écrivain anonyme.
Chantant à leur tour la fin'amor, renversant les rôles traditionnellement dévolus à l'homme et à la femme, la production des trobairitz présente un style qui peut sembler plus direct, moins formel que chez les troubadours ; sans que leurs écrits y perdent en valeur, comme nous le confirment ces quelques vers issus de la chanson "Estat ai en grèu cossirièr" de la Comtesse de Die :
Ben volria mon cavalièr
Tener un ser en mos bratz nut
Qu'el se'n tengra per ereubut
Sol qu'a lui fezés cosselhièr,
Car plus m'en sui abelida
No fetz Floris de Blanchaflor :
Eu l'autrei mon còr e m'amor,
Mon sen, mos uèlhs e ma vida.
Je voudrais bien tenir mon chevalier,
Un soir, nu, entre mes bras ;
Et qu'il s'estime comblé
Pourvu qu'il ait mon corps pour coussin
Car j'en suis plus amoureuse
Que ne fut Flore de Blanche-fleur
Je lui donne mon cœur et mon amour,
Mon esprit, mes yeux et ma vie.
(cf. Nouvelle histoire de la littérature occitane de Robert Lafont. Tome I. p.70.).
Nous ne savons pas si ces œuvres, au caractère parfois très intime, confinant même à la confession, furent interprétées en public. De nombreuses questions demeurent d'ailleurs en ce qui concerne la production des trobairitz, notamment concernant le fait que les tensons constituent le genre le plus fréquemment adopté par ces poètes. Il ne s'agit d'ailleurs là que d'une question parmi de nombreuses autres pouvant être formulées sur une production aujourd'hui connue, et tout à la fois méconnue.
Pour en savoir plus :
Ouvrages sur la question et la retranscription de chansons de trobairitz :
- ANATOLE, Christian, Las trobairitz in : Lo Gai Saber n.394, avril 1979. (Cote CIRDOC : CBB 420-27)
- BEC, Pierre, Chants d'amour des femmes-troubadours, Stock, 1995. (Cote CIRDOC : CAC 6198)
- BOGIN, Meg, Les femmes troubadours, Paris, Denoël/Gonthier, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8 BOG)
- GIRAUDON , Liliane, ROUBAUD, Jacques, Les Trobairitz. Les femmes dans la lyrique occitane. Paris, Action poétique, 1978. (Cote CIRDOC : 841.8)
- LAFONT, Robert, ANATOLE, Christian, Nouvelle histoire de la littérature occitane, Paris, 1970. (Cote CIRDOC : 849.2 LAF)
- NELLI, René, Ecrivains anticonformistes du moyen-âge occitan. La femme et l'Amour. Anthologie bilingue, Paris : 1977. (Cote CIRDOC : 841.8)
- PADEN , William, The Voice of the Trobairitz, Perspectives on the Women Troubadours, Philadelphia, 1998. (Cote CIRDOC : 841 PAD)
- ZUCHETTO, Gérard, Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée, Paris, 1996. (Cote CIRDOC : 841.8)
- AGUILERA, Delfina, Chants occitan féminins (CD), 2000. (Cote CIRDOC : 3.092 CHAN)
- AGUILERA, Delfina, Fin amor, 2011 (Cote CIRDOC 3.092 FINA)
- TROUBADOUR ART ENSEMBLE, Anthologie chantée des troubadours. XIIeme et XIIIeme siècles. Volume 3. (Cote CIRDOC : 3.092 TROB V3)