Explorar los documents (1007 total)


Chanteur guitariste dans le groupe occitan Larvath de 1975 à 1985, au sein duquel il enregistrera 5 albums, Denis Frossard a commencé à se spécialiser dans la guitare. Titulaire du Dem, il a obtenu le 1er prix de guitare à L’Ecole Nationale de Musique de Mont-de-Marsan avec Louis-Paul Juan, et poursuivi sa formation avec Denis Abatte, professeur au conservatoire de Tarbes. Passionné de musiques sud-américaine et populaire en général, il a à son actif plusieurs expériences de formations dans ce domaine, notamment dans la musique instrumentale des Andes et la polyphonie argentine. Après plusieurs stages auprès de compositeurs concertistes comme J. Cardoso, Ricardo Moyano, Raúl Maldonado ou Alberto Ponce, et parallèlement à ses propres concerts, il a également voyagé en Argentine où il a rencontré notamment le concertiste Carlos Martinez, et le directeur de la fondation Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero, qui ont reconnu son travail d’interprète et l’ont encouragé à poursuivre sur la voie de la composition et de l’arrangement.
Il a réalisé un CD avec des arrangements pour guitare des chansons d’Atahualpa Yupanqui, ainsi que des compositions personnelles, cd dont la parution a été saluée par les magazines Espaces Latino, Trad Mag, et Guitarist acoustic. Le nouveau cd de guitare d’Amérique Latine qui vient de paraître est consacré aux rythmes les plus représentatifs dans la musique populaire de ces pays (cueca, galopa, pasillo, chacarera...), tous liés à la danse, et souvent assez vifs et festifs...
Denis Frossard travaille également sur la musique traditionnelle occitane, en réalisant des arrangements pour guitare, des harmonisations pour guitare et chant, ainsi qu’une nouvelle approche dans l’exécution des rythmes. Le cd Vrenhadas (prod. Menestrèrs Gascons) paru en 2009, propose une reprise des grandes chansons du répertoire (« Carnaval », « Los Junquets », « Hilhòta de delà l’aiga »...) en duo avec Joan-Francés Tisnèr (chant), ainsi que des pièces d’ensemble ou des solos de guitare sur la musique traditionnelle occitane, avec Christian Josué (flûte à trois trous), Marc Castané (accordéon, boha) et Valérie Chabanel (guitare). La formule de concert issue de ce travail, propose tous les titres du cd et bien d’autres, avec le chanteur et musicien Joan-Francés Tisnèr, dans le duo Dus de Canta.
"Toujours dans ce domaine, il prépare une nouvelle “vendange” de danses ou de chants autour de la transhumance et du voyage, avec La Brigada Menestrèrs, ainsi que les autres musiciens et chanteurs des Menestrèrs Gascons."





Asondar : inonder. Mot à mot « recouvrir par les ondes », avec toutes les acceptions du terme. Ou bien « se déverser » : le trop-plein d'un cours d'eau, ses débordements, ses emportements, comme ceux d'une culture trop riche. Nos oreilles pourront y entendre aussi « Al son d'ara », au son et au diapason d'aujourd'hui, et elles ne s'y tromperont pas tant le groupe Asondar ressemble à son époque. Avec seulement 4 musiciens Asondar nous fait déjà faire un bon demi-tour de planète : Bretagne, Corse, Turquie, et bien sûr Occitanie, sans doute le point de rencontre de tout ce petit monde. Derrière l'apparente jeunesse du quatuor apparaissent les voyages personnels de chacun : il s'agit de Dupain, Du Bartàs, la Kreiz Breizh Akademi et Erik Marchand, Laf Duo, Bayati, Jacky Molard, Bijan Chemirani ou encore Carlo Rizzo, autant de références de prestige qui placent la musique d'Asondar dans ce nouveau paysage des musiques traditionnelles débarrassées d'une certaine tradition, mais profondément ancrées, terrestres, ethniques. La liberté du jazz, de l'improvisation, le dialogue à quatre : Asondar permet à chacune de ses composantes d'exprimer son plein potentiel au service du collectif, dans un jeu permanent où chacun va tirer l'autre vers ce qui lui est propre et cher, pour l'offrir au partage.
Le flûtiste Gurvant le Gac est à l'image du groupe : semblant être fait du même bois que ses instruments, il garde les pieds accrochés au sol alors que tout le haut de son corps se meut, ondule et s'élève lentement sans jamais quitter sa place. Oscillant entre la terre et le ciel, sa musique jaillit continuellement. On y voit là des traces de la Sòrga de Dupain (2015), groupe que Gurvant le Gac rejoignit pour développer ce répertoire : la même force brute et sensible, ce même folk progressif entêtant.
Thomas Lippens, le percussionniste « maison », suit les envolées mélodiques : rodé aux danses exaltées et exaltantes de la Méditerrannée (farandole, tarantelles...) il sait marquer d'un coup de cymbale résonnant tel un gong le début de la transe, lorsqu'après s'être cherchés, reconnus, jaugés, les musiciens s'emportent vers d'autres hauteurs dans un tourbillon qui retombera plus tard, plus loin, lent et calme.
Une force puis un calme maintenus et soulignés à demi-voix par Pauline Willerval. A demi-voix et à demi-violoncelle, les deux se rejoignant souvent : on sait la ressemblance du son de l'instrument avec celui de l'organe humain. Avec le bruit de certains éléments naturels aussi, et la musicienne passera régulièrement de la rythmique de cordes à la douceur mélodico-mélancolique de la gadulka, une vielle à archet bulgare, colorant l'ensemble d'airs turcs, des Balkans ou du bassin méditerranéen.
Au cœur du groupe et du projet, Titouan Billon, musicien poly-instrumentiste qui n'use ici que de sa voix, tout à la fois jeune et incroyablement forte et assurée, et que l'on avait déjà pu apprécier dans Du Bartàs ou encore Lo Barrut. De son expérience poético-polyphonique, il en a gardé l'amour pour les mots de Léon Cordes, surtout ceux de la terre, qu'il se plaît à chanter, déclamer, lancer à la volée. Ce sont eux qui « asondan » régulièrement le concert, en constituent le cœur, avec d'autres, de traditionnels revisités, voire recréés.
Folk progressif, jazz digressif, avec une base traditionnelle très assurée, à tel point que les musiciens finissent par redécouvrir, presque à leur insu, des liens cachés entre les répertoires et apprennent petit à petit à les exploiter et les porter en commun avec des spécificités qui ne sont à aucun moment des différences.
L'ensemble, pas si hétéroclite, prend le temps de se construire, de se créer sous nos yeux et dans nos oreilles à force de boucles rythmiques et mélodiques d'où s'échappent par à-coups des petites improvisations et variations personnelles. Asondar progresse par vagues, frêles mais sûres, un va-et-vient constant qui donne l'impression d'à peine nous effleurer alors même que nous sommes déjà, sans l'avoir senti venir,...asondats.
Asondar sort de résidence de création au Chantier à Correns (Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde) et font partie du Collectif marseillais FeM, qui devrait livrer d'autres surprises et créations de haute volée dans les années à venir.




La literatura publicada dins aqueles recuèlhs es estada sovent criticada car jutjada tròp populara. D’unas d’aquelas publicacions durèron gaire, d’autras existisson encara, una pichòta desena d’almanacs occitans contunhan de paréisser a l’ora d’ara.


Avec la voix de Pèir Brun.






Source

Resumit
En 1930, Prosper Estieu publica un de sos darrièrs recuèlhs originals, Lo fablièr occitan, que recampa de faulas del monde entièr, traduchas en occitan. Emai siá pas estat pensat aital, apareis coma una emanacion originala de l’idèia de « convivéncia » dins la literatura occitana de la debuta del sègle XX.
Referéncia bibliografica del recuèlh

ESTIEU, Prosper. Lo fablièr occitan. Castèlnòudari : Societat d'Edicions Occitanas, 1930, 168 p.
Note d’étude
Retrobam dins aquelas faulas la quita idèia de la « convivéncia » tala coma es definida a l'ora d'ara per Alem Surre-Garcia :
« L'art de viure ensems dins lo respècte de las diferéncias en tèrmes d'egalitat »
La coabitacion d'una multiplicitat de culturas es pas gaire susprenenta dins un tal recuèlh puèi que lo genre literari de la faula se bastiguèt sus la tradicion de recuperacion de racontes ancians, en particular amb las òbras d'Esòp e de Fèdre.
Al delai de las importantas reinterpretacions culturalas inerentas al genre de la faula, Lo fablièr occitan se plaça tanben dins la dralha del movement Orientalista alara de mòda en Euròpa occidentala tant dins lo domeni de la literatura que dins lo de las arts plasticas. Prosper Estieu, sensible a aquel movement literari e artistic s’es fòrça largament inspirat del grand autor francés Victor Hugo, que s’èra el tanben ensajat al genre coma dins son recuèlh de poèmas Les Orientales (1829). 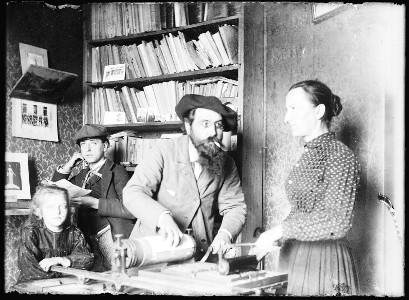
Pasmens Lo fablièr occitan es pas la sola òbra de Prosper Estieu a faire resson a la nocion de «convivéncia». En efècte, Estieu se clinèt sus l'Edat Mejana tre los primièrs numèros de la revista Mont-Segur (1901-1904), qu'estampava del sieu domicili e al dintre de la quala pausava coma question centrala l'influéncia contemporanèa de la civilizacion medievala occitana, largament dubèrta cap a l’Orient.
Per ne saber mai sus Prosper Estieu e son òbra : http://vidas.occitanica.eu/items/show/2077