Explorer les documents (36 total)


Dans le contexte tumultueux de la Guerre de Cent Ans (1337-1453) qui oppose royaumes de France et d'Angleterre, il marque son temps par son sens aigu de la politique et son amour des arts et des lettres. Si l'on retient surtout les faits d'armes de ce stratège militaire, le faste de sa cour et les débordements de son caractère, Fébus eut également un rôle prépondérant sur le développement de la langue et de la culture occitanes au XIVe siècle.


Las Voses de la modernitat - Les voix de la modernité est une invitation à découvrir une création poétique vivante et riche, en dialogue avec le Monde et l'Histoire, loin du cliché d'une culture occitane forcément « provincialisée ». Célébration de l'oralité poétique, ce parcours virtuel permet d'accéder à des extraits mais également à des textes complets et donne à entendre, lorsque le document existe, le poème mis en voix, parfois dans la voix du poète lui-même. C'est un parcours virtuel dynamique, qui sans chercher à l'exhaustivité, évolue au gré des rencontres et des projets.

Notre réponse :
Quelques spécialistes de la tradition orale française, en particulier Georges Doncieux (1856-1903) et Patrice Coirault (1875-1959), se sont penchés sur les origines de cette chanson et la font remonter au XVe siècle.
Sources anciennes du chant :
-
Manuscrit de Bayeux, Chansons Normandes du XVème siècle.
Consulter l'ouvrage en ligne -
Ms. NAF 6771 : Recueil de chansons italiennes et françaises, avec musique notée, copiées en Italie, XVe siècle.
Consulter l'ouvrage en ligne -
Ms. NAF 4379 : Recueil de chansons, motets, etc., en français, latin, italien et allemand ; avec musique notée, XVe-XVIe siècles.
Voir la description du document -
Marbrianus de Orto, Misse... Dominicalis, J'ay pris amours, cum duobus Patrem, l'omme armé, la bella se sied, Petita camuseta, Venezia : Petrucci, 1505.
Consulter l'ouvrage en ligne -
Adrien Le Roy, QUART LIVRE DE CHANSONS, // composées à quatre parties par bons et excellents musiciens, // Imprimées en quatre volumes. [Marque de Le Roy et Ballard.] // A PARIS. De l'imprimerie, d'Adrian le Roy, et Robert Ballard, Imprimeurs du Roy, // rue S. Iean de Beauvais, à l'enseigne S. Genevieve. 2. Decembre 1553. // Avec privilege du Roy pour neuf ans. //, [S.l.] : [s.n.], 1553
Consulter l'ouvrage en ligne -
La Fleur des Chansons amoureuses où sont comprins tous les airs de Court recueillis aux Cabinets des plus rares poètes de ce temps,Rouen : Adrian Delaunay, 1600, p. 378
-
Non le tresor ny le trias ne le cabinet, moins la beaute, mais plus, la fleur ou l'eslite de toutes les chansons amoureuses et airs de court. Tirez des oeuvres et manuscripts des plus fameux poëtes de ce temps, Rouen : chez Adrian De Launay, 1602.
-
Airs de Cour comprenans le trésor des trésors, la fleur des fleurs et eslite des chansons amoureuses, extraites des oeuvres non encor cy devant mises en lumière des plus fameux et renommez poètes de ce siècle, Poitiers : P. Brassart, 1607
Consulter l'ouvrage en ligne -
Meslanges de musique de Jacques Le Fèvre, Paris, P. Ballard, 1613.
-
Manuscrit Livre des vers du lut, conservé à la bibliothèque Méjanes, début du XVIIème siècle.
Voir la description de l'ouvrage -
Le Dernier Trésor des chansons amoureuses. Recueillis de plus excellents airs de court, et augmentez d'une infinité de très belles chansons nouvelles & musicales, A Rouen : de l'immpie de Martin Le Mégissier tenant sa boutique au haut des degrez du Palais, 1614.
Voir la notice de l'ouvrage -
Manuscrit : Recüeil de chansons plus anciennes que nouvelles... copiées pendant mon séjour à la Grange-aux-Ormes en 1761. Pour Mlle B.A., 1761.
-
Jules Borgnet, Les passe-temps d'un greffier d'autrefois, Messager des sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Belgique, XIII, 1851.
-
Stainer, John, Dufay and his contemporaries, fifty compositions ranging from about A. D. 1400 to 1440, transcribed from Ms. Canonici misc. 213 in the Bodleian Library Oxford, by J. F. R. Stainer,... and C. Stainer, with an introduction by E. W. B. Nicholson,... and a critical analysis of the music by Sir John Stainer,..., London : Novello, 1898.
Voir la notice de l'ouvrage
Versions occitanes du chant La Pernette :
-
Alphonse Lamarque de Plaisance, Usages et chansons populaires de l'ancien Bazadais, Bordeaux : [s.n.], 1845.
-
Bladé, Poésies populaires de la Gascogne, Tome III : chansons de danse, Paris : Maisonneuve, 1881.
Consulter l'ouvrage en ligne
Localiser les exemplaires de l'ouvrage -
Abbé Léopold Dardy, Anthologie populaire de l 'Albret : sud-ouest de l'Agenais ou Gascogne landaise, Agen : J. Michel et Médan, 1891.
Consulter l'ouvrage en ligne
Localiser les exemplaires de l'ouvrage -
Henry Vaschalde, Chansons populaires du Vivarais, : Paris : E. Lechevalier, 1897.
Localiser les exemplaires de l'ouvrage -
Almanac patoues de l'ariejo : 1899, 16
-
Daymard Joseph, Vieux chants populaires recueillis en Quercy, Cahors : Girma, 1889
-
Eugène Cheminade, Les vieilles chansons patoises du Périgord, Périgueux : Cassard jeune, 1902.
Consulter l'ouvrage en ligne -
Chants populaires du Rouregue recueillis et publiés par la Solidarité aveyronnaise, Rodez : imprimerie Carrère, [1910]
Localiser les exemplaires de l'ouvrage -
Recueil formé par M. Victor Smith, de Saint-Étienne (Loire), sur la littérature populaire du Forez et du Velay
Voir la description du document -
Manuscrit : Poésies populaires de la France, recueillies par les soins du comité des travaux historiques, XIXème siècle.
Consulter le document en ligne
Études sur le chant :
-
Georges Doncieux, La Pernette : origine, histoire et restitution critique d'une chanson populaire romane IN Romania, Paris : Société des amis de la Romania, T. 20, 1891.
Consulter l'article en ligne -
Vincent d'Indy, La Pernette IN Chansons populaires recueillies dans le Vivarais et le Vercors par Vincent d' Indy, mises en ordre, avec une préface et des notes par Julien Tiersot..., Paris : Heugel, 1892.
Localiser les exemplaires de l'ouvrage
Consulter l'ouvrage en ligne -
Patrice Coirault, La Pernette IN Répertoire des chansons françaises de tradition orale, I. La poésie et l'amour, Paris : BnF, 1996. p.153


Flamenca est un roman anonyme de 8095 vers octosyllabiques composé en ancien occitan vers le milieu du XIIIe siècle.
L'oeuvre raconte les amours de Guilhem de Nevers, jeune chevalier français doté de toutes les vertus physiques et morales, et de la belle Flamenca.
Le récit commence par la demande en mariage de Flamenca par Archambaut de Bourbon. Les noces sont célébrées avec faste à Nemours pendant huit jours puis suivent les festivités de l’arrivée de Flamenca à Bourbon. La description extraordinairement détaillée des fêtes de Bourbon, des danses, des musiques, des œuvres littéraires qui sont jouées, « le plus incroyable déploiement de culture vivante dont on puisse rêver » selon Yves Rouquette, ont fait de Flamenca un portrait exceptionnel de la société courtoise et ont pu lui donner l’image d’un roman historique.

Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Archives municipales
En savoir + sur Marguerite Genès : consulter l'article dans vidas.occitanica.eu
Marguerite Genès a tenu un carnet régulier pendant toute la durée de la guerre de 1914-1918. Conservés aux archives municipales de Brive-la-Gaillarde, ces manuscrits inédits sont progressivement publiés sur un site dédié, réalisé avec les élèves du lycée Georges Cabanis. Le site 14-18.brive.fr fait partie des projets labellisés par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
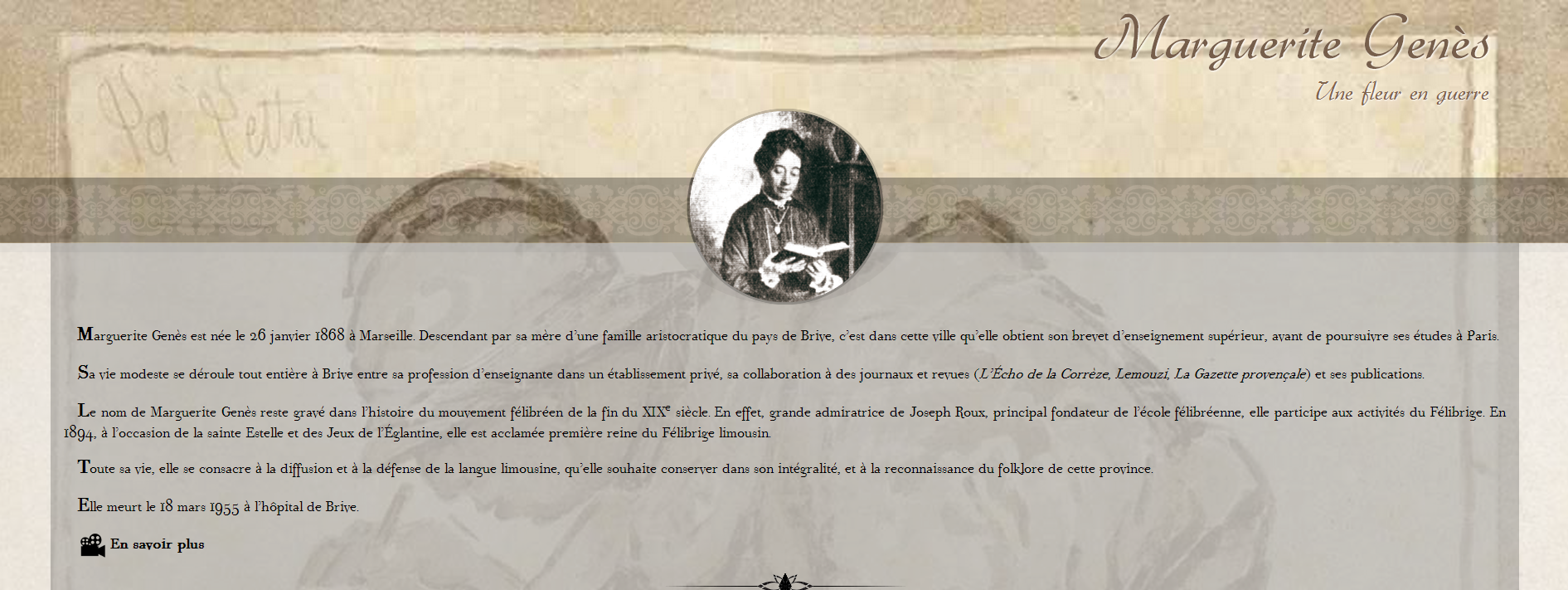


Ses liens avec le milieu occitan sont multiples : il illustre des textes de Marie Rouanet, notamment Oremus pour un produit de consommation en 1970, et d'Yves Rouquette (Messa pels porcs, Misericordias, etc.). Dans ses linogravures pour La Boca a la paraula (texte écrit par Joan Larzac, 1971), il emploie son nom sous sa forme occitane : "Pèire Francès".
[imatge id=21608]Dans les années 1970, continuant à illustrer des textes occitans, il réalise de nombreuses couvertures pour la collection A tots de l'IEO et des pochettes de disque pour les productions Ventadorn. Il crée également des décors, costumes et affiches pour deux pièces du Théâtre de la Carrièra.
En 1974, il collabore avec le Théâtre des Carmes d'André Benedetto, sur la pièce Esclarmonda entre autres. La même année, il participe à la Mòstra del Larzac.
Pierre François a également collaboré avec le CIDO (Centre international de documentation occitane, à l'origine du CIRDÒC) notamment sur l'exposition De la natura de quauquas bèstias dont les textes sont signés Yves Rouquette.
Consultez ici le site officiel de Pierre François

Brun, Jean-Frédéric
Ubaud, Josiane
Forêt, Jean-Claude
Barral, Guy
Navarro, Lionel


Torreilles, Claire (1946-....)
Verny, Marie-Jeanne
Forêt, Jean-Claude
Gouiran, Gérard (1945-....)
Martel, Philippe (1951-....)
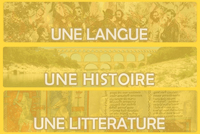 L'Université Ouverte des Humanités recense, coproduit (avec ses établissements partenaires) et met librement à disposition des étudiants et enseignants des ressources numériques pédagogiques.
L'Université Ouverte des Humanités recense, coproduit (avec ses établissements partenaires) et met librement à disposition des étudiants et enseignants des ressources numériques pédagogiques.
Celle-ci a pour titre "L'occitan...Une langue, une littérature, une histoire"
L'occitan, une langue :
"L'occitan, langue millénaire, est avant tout une langue romane avant d'être la « langue régionale » que l'on connaît aujourd'hui. Elle possède un espace linguistique bien défini et des caractéristiques qui lui sont propres. Et si, face à l'institutionnalisation du français, elle s'est vue progressivement déclassée, la langue occitane n'en occupe pas moins aujourd'hui encore une place à part dans le paysage linguistique français."
L'occitan, une littérature :
"Phénomène étrange et inclassable, la littérature occitane est ici proposée selon un parcours historique présentant les quatre grandes périodes qui distinguent communément la littérature d’oc : l'âge d'or médiéval (Xe – XIIe siècles), la première renaissance dite aussi « baroque » (XVIe – XVIe siècles), la deuxième renaissance du XIXe siècle avec notamment le Félibrige, la troisième renaissance (XIXe et XXIe siècles)."
L'occitan, une histoire :
"Il y a un espace linguistique d'oc, d'accord. Mais est-il aussi un espace d'histoire? Ce n'est pas évident au premier abord. Il ne se trouve pas en effet de territoire immédiatement identifiable sur une carte politique, historique ou géographique, portant le nom d'Occitanie, et le terme ne s'inscrit pas en dehors du milieu militant. Et pourtant, ceux qui ont parlé la langue d'oc au fil des siècles ont une histoire. C'est elle que nous vous proposons ici de découvrir."


Le médecin de Cucugnan
Que ne faut il pas faire, pour gagner sa vie ! Attention moi ici, Bernadon, croquemort, garde champêtre, sonneur de cloches, chasseur de chiens errants, homme à tout faire de Cucugnan, je me vois sur le point de devenir rapidement le déterreur de ressuscités !
Douze métiers, treize misères ! C'est ainsi. Sur terre, il faut que chacun trouve le sel qui fait bouillir la marmite.... D'autres sont plus à plaindre que moi, à Cucugnan.
Je pense à ce pauvre Maître Lapurge, notre pauvre médecin, qui depuis deux ans qu'il est ici, n'a pas encore un seul patient.... Que voulez vous ? C'est un peu de sa faute. Pourquoi donc, se promène t il toujours un livre à la main ? Il ne doit pas savoir grand chose, étant donné qu'il étudie sans cesse. S'il étudie, c'est pour apprendre ; s'il a besoin d'apprendre, c'est qu'il ne sait pas ; s'il ne sait pas, qu'est-il venu faire à Cucugnan ?
Aussi, quand ici, il y a quelque malade, ce n'est pas lui qu'ils viennent chercher, allez ! Pauvre maître Lapurge ! Il ne gagne pas l'eau qu'il boit! Cela se comprend qu'il soit las d'être une lampe sans huile, et il s'est enfin décidé a faire parler de lui. Hier il m'a fait annoncer dans toutes les rues qu'il se chargeait, non seulement de guérir un malade, mais de ressusciter un mort. Oui, un mort, un mort enterré !
Extrait tiré de : «Lo Mètge de Cucunhan» de Jan de La Roca (Prosper Estieu), Societat d'Edicion Occitana, Castelnaudary, 1926.


La petite guenon et le clown
Il était une fois, un clown, une paillasse comme on dit chez nous. Ce n'était pas un comique de la sainte fleur, pas moins il savait un peu faire rire, un peu faire peur, néanmoins, un brave clown au plus profond de son cœur !
Il avait une petite guenon. Il l'appelait Mon Cœur. Elle était plus que jolie, terriblement intelligente et bougrement coquine en même temps. Le clown l'aimait bien sa petite guenon.
Quand il faisait chaud, c'était Mon Cœur qui allait chercher l'eau ; quand il faisait froid, c'était Mon Cœur qui allumait le feu. Finalement, elle n'était pas tant haïssable que ça, la Mon Cœur...
Néanmoins, elle avait la pire des habitudes : chaque fois que la lune était ronde dans le ciel, elle voulait monter jusqu'à elle, de toutes ses forces elle voulait sauter sur elle, elle pleurait, elle faisait des caprices, elle pleurait que c'était le clown qui ne voulait pas la laisser aller sur la lune.
Elle devenait impossible et le pauvre clown devenait malheureux, tant malheureux que les gens disaient:
«Il est si triste ce pauvre clown ! Ce n'est pas possible, c'est un bouc émissaire !".
Vite vite, le clown se précipitait chez la marchande de grimaces, de moues et de postiches. Il en achetait à s'en remplir les poches. Il retournait dans son cirque, il en mettait un sur son nez, et se jetait sur la piste, « clowner » tant et si bien que les gans frappaient dans leurs mains...
Extrait tiré de : Alranq, Claude, La monina e lo palhassa, I.E.O.-Aude, Quillan, 1996.